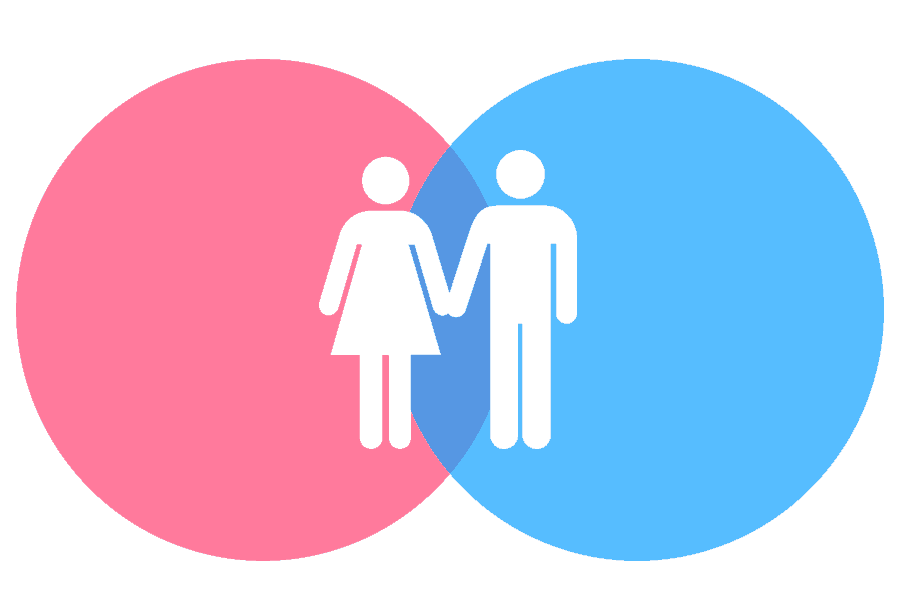Dans un article paru aujourd’hui, Marianne revient sur le sujet très débattu des violences conjugales en posant une question évidente mais essentielle : « Violences conjugales : qui voudra voir que l’agresseur peut être une femme ?
Agresseur – femme : un oxymore ?
Est-il si difficile d’admettre que la violence conjugale est une réalité qui ne concerne pas que les femmes ? Qu’elle n’est pas un phénomène univoque ?
La violence ne serait-elle qu’une spécificité masculine ? Les hommes, parce qu’ils seraient perçus comme « plus forts » que les femmes selon des critères physiques, ou « plus agressifs » selon des critères hormonaux ou psychiques, seraient-ils les seuls capables d’user de violence envers leur conjointe ?
Une femme n’est pas capable aussi de se montrer violente, de harceler un homme verbalement, physiquement, psychologiquement, ou sexuellement ?
Et si l’on va plus loin, n’existe-t-il pas au cœur du féminisme une forme d’hyperviolence manifeste et arbitraire, travestie en prétention justicière, égalitaire ou libertaire ?

Nos croyances sexistes ont la vie dure ! Toujours cette fameuse différenciation sexuelle et physique, matrice de tous les stéréotypes ou croyances véhiculées depuis des lustres quant aux déterminismes comportementaux liés au sexe.
Nous sommes tellement conditionnés par les discours que le terme même de « violences conjugales » évoque immédiatement des violences infligées par un mari à sa femme : menaces, intimidations, humiliation, cris, coups et blessures, viols conjugaux, allant parfois jusqu’au meurtre – pardon, au « féminicide ».
Nous reviendrons sur le sens de l’imposition de ce néologisme…
Soyons très clairs : il n’y a nul lieu ici de relativiser, de minimiser, de prétendre occulter ou d’ironiser sur une réalité qui est un drame réel pour beaucoup trop de femmes. Un drame personnel pour les victimes elles-mêmes, mais aussi souvent pour leurs enfants et leur entourage. Un drame social et collectif pour une société incapable de les prévenir et d’y apporter des solutions efficaces.
La violence conjugale, et plus largement les violences faites aux femmes, sont une réalité statistique et juridique. Mais aussi un thème récurrent qui traverse depuis des générations les discours, les représentations, les schémas culturels et même politiques.
Cette violence est aujourd’hui partout commentée, condamnée, reproduite et mise en scène dans un très grand nombre de films, de romans, de talk-shows, de séries télé.
Un thème « social » souvent associé aux ravages de l’alcoolisme, du chômage, à la délinquance, aux frustrations personnelles, à des déséquilibres psychiques ou une « enfance malheureuse ». Mais aussi au fanatisme religieux, notamment musulman, qui en excuse et en préconise même l’usage d’une façon déclarée « licite », comme le viol conjugal.
Au 19e siècle, sous la plume d’écrivains comme Zola dans La Bête humaine, il était d’usage pour dépeindre la misère propre à cette classe dite « prolétarienne », de décrire avec les codes du roman naturaliste ces violences conjugales comme un fait coutumier, un phénomène social parmi d’autres, et de présenter cette violence comme un synecdoque ou une allégorie de la violence propre à toute la société.
Cette société injuste, « capitaliste et bourgeoise » fondée sur « l’oppression de l’homme par l’homme », selon la bonne vieille grille de lecture marxiste. Une violence sociale génératrice d’autres violences publiques ou privées.
Cependant ce n’est ni Marx ni la Révolution ni les utopies en vogue qui libéreront les femmes.
Ce sont les femmes elles-mêmes !
Le mouvement d’émancipation des femmes dans la société industrielle démarre en Europe à la fin du 19e siècle et se structure au début du 20e siècle.
Notamment après cette Grande guerre où les femmes auront joué un rôle essentiel, prenant en mains les rênes des nécessités domestiques, agricoles, économiques, politiques, pendant que les hommes étaient occupés à combattre au front. Pendant que ces « poilus » s’entretuaient pour pas grand-chose, leurs femmes prirent leur place, faisant tourner les fermes, les écoles, les dispensaires, les mairies, les ateliers, les usines, les administrations… pour que la vie continue.
Les très festives et permissives Années folles qui suivirent virent exploser le mouvement des suffragettes : les femmes britanniques, suivies de près par les sœurs américaines, n’entendirent plus cette fois se contenter de faire tourner la boutique pendant que leurs maris jouaient à la guerre. Elles exigèrent droits, à égalité avec les hommes, et le firent savoir haut et fort !
Un tremblement de terre. Une révolution. Dans cette société victorienne encore très corsetée, puritaine, où chaque lady se devait de rester à sa place, respecter son mari, bien élever ses enfants, être une mère attentive et dévouée et une épouse modèle.
En France il faudra tout de même attendre 1947 pour que les Françaises accèdent au droit de vote au suffrage universel. Et 1965 pour qu’elles aient le droit d’ouvrir un compte sans l’autorisation de leur mari.
Ces turbulentes années 1960/70 sonnèrent précisément le grand Réveil pour toutes les aspirations aux « Changement ». Elles marquèrent le tournant majeur pour les nombreuses revendications libertaires portées par une jeunesse rebelle aux cheveux longs, bercée par le rock, enivrée par de nouveaux rêves de liberté et des idéaux fleuris, parfumés de marijuana et irisés par le LSD.
Un grand bazar éclectique et bon enfant où venaient se brasser toutes les utopies. Et qui donna une conscience politique à une jeunesse de baby-boomers gâtés par la croissance économique et une société de consommation matérialiste dont ils contestaient pourtant ardemment les fondements. Une jeunesse non-conformiste, altruiste et désinvolte qui manifestait volontiers, et faisait beaucoup de bruit pour réclamer de nouveaux droits, proclamer la liberté sans limites et la paix universelle, en dénonçant cette absurde Guerre du Vietnam.
Parmi les causes humanistes qui ont le plus progressé durant cette décennie glorieuse qui marqua l’apothéose des gauchistes et des hippies de toutes tendances (1966-1974), il y a bien sûr les droits civiques pour les Afro-américains, ceux des « travailleurs » avec les accords de Grenelle, et surtout cette fameuse Révolution sexuelle, cette frénésie de plaisirs militant pour l’abolition de tous les interdits moraux liés au sexe. Une révolution des mœurs et de la sexualité favorisée par l’invention de la pilule contraceptive (1968), l’exploration des paradis artificiels et des substances désinhibitrices, et le triomphe des théories psychologiques et psychanalytiques prônant la liberté sexuelle absolue comme celles de Wilhelm Reich.

Les minorités LGBT ont été parmi les premières à porter ces revendications sur la scène publique et politique aux côtés des féministes, forçant une majorité frileuse et moraliste à jeter leur regard sur ces réalités honteuses et refoulées.
Quant aux mouvements féministes, souvent alliés des mouvements défendant la cause homosexuelle, ils accèdent à partir de cette période à une visibilité politique et médiatique jusqu’alors inégalée.
Une véritable prise de conscience sur le rôle des femmes dans la société et les identités sexuelles se produisit alors, qui toucha toutes les femmes, mais aussi de nombreux hommes engagés à leurs côtés pour faire évoluer la société.
Mais le mouvement féministe qui défendait leur cause, porté ou relayé par de brillants intellectuels progressistes de renom, prit aussi un tournant idéologique et politique beaucoup plus « radical » à partir de cette période.
Il ne s’agissait plus alors simplement de revendiquer des droits à égalité avec les hommes, mais de mettre carrément à bas cette « société oppressive, bourgeoise et capitaliste » et « l’ordre patriarcal, machiste et hétérosexiste » sur lequel elle se fondait.
La lutte pour les droits des femmes s’inscrivait alors quasi immanquablement dans une perspective « révolutionnaire ». Dont l’objectif était de ruiner les fondements de la société, de l’ordre établi, de la morale et de la politique. D’abattre les « pouvoirs » conservateurs qui le maintenaient et organisaient la répression, afin de bâtir une nouvelle société idéale, plus libre, plus juste, plus égalitaire, plus humaine, dans un vaste mouvement d’émancipation global qui marquerait le triomphe de tous les opprimés contre leurs anciens oppresseurs.
Ce lyrisme romantique directement inspiré des mythes et de la dialectique marxistes, cette mythologie libertaire, cette rhétorique révolutionnaire, ce rêve émancipateur et cette épopée héroïque digne de la Sortie d’Egypte, ont été bien entendu exagérés, surjoués et reproduits à l’infini.
Les années 1980, beaucoup plus froides et cyniques, allaient marquer la fin de ce rêve « révolutionnaire ». Et le retour au réalisme pragmatique sur fond de crise économique. Avant cela, il était pratiquement impossible aux intellectuels et aux acteurs de la gauche révolutionnaire ou de progrès d’élaborer un discours social et politique qui s’affranchissent des canons idéologiques, politiques et rhétoriques imposés par la doxa freudo-marxiste.
Les droits des femmes et surtout leur place dans la société a considérablement évolué. Mais ces acquis n’ont cependant pas totalement évacué les prétentions « révolutionnaires » de certaines féministes.
Sauf que la révolution a depuis changé de visage, et le combat de forme.
Il a abandonné pour l’essentiel ses référents freudo-marxistes, trop démodés.
Encore qu’il en reste de sérieux vestiges et de curieuses résurgences dans ces réflexes discursifs propres à la rhétorique féministe. « Patriarcat », « sexisme » ou « hétérosexisme », « l’oppression masculine »… : autant de thèmes toujours actuels qui recouvrent des clichés idéologiques fondés comme toujours sur une vision caricaturale, manichéenne et hyper morale de la réalité : les bons d’un côté, les méchants de l’autre, les bourreaux d’un côté, les victimes de l’autre, etc…
Depuis les années 2000, ces clichés ont été acclimatés et édulcorés par la fameuse « théorie du genre ». Laquelle n’a jamais existé que dans les fantasmes des conservateurs hostiles aux progrès juridiques et sociétaux concernant les droits LGBT ou les avancées médicales en matière de procréation assistée.
En revanche les études de genre, principalement anglo-saxonnes, ont apporté un éclairage nouveau sur les réalités liées au genre. En permettant notamment de différencier sexe et genre. Et de distinguer les assignations culturelles, anthropologiques ou sociales liées aux stéréotypes de genre de l’appartenance personnelle à tel ou tel genre.
Les discours sur le genre tendent aujourd’hui de plus en plus à privilégier une compréhension selon une logique « constructiviste » du genre (masculin, féminin et autres genres intermédiaires comme neutre ou « non-binaire », trans, androgyne, queer…) plutôt que sur une logique « déterministe » selon laquelle chaque individu en fonction de son sexe de naissance (mâle ou femelle) est automatiquement déclaré « homme » ou « femme ». Avec toutes les assignations identitaires, psychiques, comportementales, culturelles, sociales attachées à chaque genre. Toute écart par rapport à ces modèles étant considérée comme anormal ou transgressif, et devant être réprimé.

Cette évolution est d’une importance capitale et sans doute irréversible.
Car désormais le fait d’être un homme ou une femme n’est plus considéré comme un critère imprescriptible pour se conformer et se limiter à des rôles et des comportementaux sociaux, des stéréotypes et des attributions supposés relever de façon exclusive d’un genre ou de l’autre.
En d’autres termes les jeunes garçons n’ont pas à jouer aux mecs en se bagarrant, et les petites filles à rester bien sages en jouant à la poupée, pour correspondre à ce que leurs parents ou la société attend d’eux.
En outre il devient de plus en plus admissible que des personnes, pour des raisons multiples, ne se définissent pas par rapport à une vision dichotomique et segmentée du genre : homme vs. femme.
Ces réalités ont toujours existé mais pendant longtemps elles n’avaient pas été admises ni validées de façon positive dans les discours. Ceux qui s’écartaient de la norme en raison d’une sexualité ou d’un comportement jugé « déviant » (les homosexuels par exemple), ceux qui refusaient de se plier à des obligations sociales prescrites par leur appartenance au genre masculin (comme le fait de se faire réformer de service militaire) étaient montrés du doigt, raillés, voire persécutés.
Aujourd’hui un homme n’a pas besoin d’exhiber son phallus, de monter ses muscles, d’afficher ses conquêtes ou de vanter ses prouesses sexuelles, encore moins d’être une brute épaisse, un prédateur sexuel ou une star du ring pour prouver qu’il est un homme, « un vrai ».
Aujourd’hui les hommes ont le droit d’exprimer leurs émotions, leur sensibilité, leur fragilité, de s’occuper de leur bébé avec délicatesse, sans que l’on doute de leur virilité.
D’ailleurs la virilité, qui est une authentique qualité et même une vertu quand elle est bien comprise, n’a rien à voir avec des démonstrations de force, avec la vigueur sexuelle, ni même avec l’exhibition d’une barbe fournie comme substitut de masculinité, comme beaucoup de jeunes hommes se sentent obligés de la faire depuis une dizaine d’années.
La virilité, qui se définissait autrefois comme la vertu de l’homme mûr, dans la force de l’âge, mais aussi celui du soldat et du citoyen prêt à défendre son honneur et celui de l’empire, est aux antipodes de ce que beaucoup de sous-hommes frustrés s’imaginent.
La virilité en vérité, est une qualité « morale » (et politique).
Elle ne ressemble en rien à cette caricature grossière à laquelle s’attachent beaucoup d’hommes pour combler un déficit personnel de virilité ou d’estime de soi et qui se traduit par une exaspération forcée, exhibitionniste et narcissique des caractères physiques considérés comme « positifs » de la masculinité : musculature développée, force physique supérieure à la moyenne, insensibilité à la douleur, puissance agressive et conquérante, libido surdéveloppée, exhibition de signes extérieurs de pouvoir ou de richesse…

Cette vertu morale qu’est la virilité peut se résumer à la capacité à faire face à toutes circonstances, à combattre l’adversité tout en restant juste et maître de soi.
Cette compréhension de la virilité a ses codes culturels et une histoire.
Dans la Grèce hellénistique, puis dans l’Empire romain, cette conception de la virilité au cœur de l’édification politique et sociale de la Cité, s’exprimait notamment dans les codes de la statuaire antique représentant des modèles masculins sous les traits de soldats, de champions, de gladiateurs, de héros mythologiques, de patriciens ou d’empereurs romains.
Ces représentations n’avaient pas pour objectif de montrer des hommes bien faits et virils en apparence, mais de laisser entrevoir au travers de ces modèles les qualités et les vertus morales qui fondent l’Idéal de l’homme viril et vertueux. En construisant un « type » physique constitué de formes, de représentations, de codes symboliques et esthétiques qui synthétisent et donnent à contempler ce qui est a priori impossible à figurer plastiquement et relève de l’essence plutôt que de l’apparence. Du fond plutôt que de la surface. De l’intériorité plutôt que de l’extériorité.
Ce qui est suggéré au travers de ces formes ce n’est pas les qualités objectives d’un guerrier ou d’un homme de pouvoir, mais les qualités morales et le caractère exemplaire du parfait citoyen de la République. Du patricien ou de l’empereur qui incarne les vertus romaines. Une vertu personnelle, collective et politique qui ordonne la société et fonde l’Etat. Et qui se caractérise souvent par l’éducation, l’aptitude à affronter l’adversité, à combattre pour défendre le rayonnement, les idéaux et l’honneur de l’empire ou de la patrie.
Mais aussi également une rigueur morale personnelle et comportementale centrée sur la maîtrise de soi.

Poséidon

Jules César
Un homme vertueux et « viril », était celui qui savait maîtriser sa force, ses désirs, ses pulsions, ses appétits, ses passions. Et qui jamais ne se complaisait à y céder de façon excessive ou désordonnée. Que ce soit dans la débauche, l’avilissement physique, psychique ou moral, l’usage immodéré des plaisirs, le relâchement, l’intempérance, la paresse, la cupidité, la gourmandise, la forfaiture, les excès et bassesses en tous genres.
Un homme était celui qui en toutes circonstances pouvait rester maître de lui-même. Qui jamais ne se laissait déchoir de son rang et jamais ne défaillait à sa mission, à ses obligations politiques, militaires, morales et citoyennes. Démontrant ainsi qu’il était capable de diriger les autres, sa famille, son clan, sa cité, son armée ou son pays, avec une égale et constante vertu.
On retrouve à peu près le même schéma d’idéalisation des vertus dans la société féodale et chrétienne. Notamment dans le chevalerie, les codes d’allégeance et ceux de l’amour courtois. Un chevalier, même encore aujourd’hui dans le langage courant, n’est-il pas un homme qui sait bien se conduire de façon noble et courtoise avec les femmes, comme il sait se montrer vaillant au combat, juste et généreux envers les faibles et loyal avec son suzerain ?

Si l’on extrapole cette vertu morale qui déterminent les traits de la « noblesse » non pas de sang mais d’esprit, cette conception de la virilité qui n’a rien de « sexiste » peut tout aussi bien être considérée comme une vertu dont peuvent également faire preuve beaucoup de femmes. Des femmes dont la force morale, la droiture, la capacité à se gouverner et à gouverner les apparentes à ces qualités a priori attribuées aux hommes. Sans pour autant que cela ne nuise à leur nature ni à leur féminité.
Une femme vertueuse selon ces canons éthiques appliqué à l’homme viril démontre un esprit viril, ferme et juste. Ce qui n’enlève rien nécessairement à sa sensibilité, sa douceur, son charme, toutes des qualités réputées féminines.

Les femmes n’ont pas besoin de pasticher les hommes pour prouver leur légitimité à exercer le pouvoir. A s’habiller en tailleur et pantalon, voire cravate, pour jouer les business women, montant ainsi qu’elle ont pris la place de hommes.
Ce serait fétichiser et le pouvoir et les codes qui régissent les apparences extérieures de la fonction comme de la masculinité.
Hélas notre époque préfère les raccourcis et les schémas réducteurs aux nuances. Beaucoup s’y laissent malheureusement piéger.
Du côté des hommes en manque de virilité, se prétendent aujourd’hui « virils » tous ces petits caïds de banlieue rebelles et ridicules, immatures, vulgaires, misogynes, homophobes, arrogants et provocateurs. Des pervers narcissiques esclaves de leurs complexes permanents d’infériorité, et qui confondent arrogance et autorité, violence et force, intimidation et ascendant, obscénité et séduction. Des faux hommes, des « spécieux ridicules« , qui n’ont absolument aucune considération ni pour les autres ni pour une société qu’ils haïssent, parce qu’ils lui reprochent injustement de leur refuser cette reconnaissance qu’il mérite par le seul fait d’exister.
Les violences sexistes actuelles sont sans doute en grande partie le fruit de cette valorisation excessive par les médias et les bien-pensants d’une déshérence, d’une vacuité morale et d’une médiocrité arrogante érigées en modèle subversifs et en fausses vertus.
Cette perversion, cette inversion des valeurs, cette perversion des modèles de la virilité contaminent même les femmes. Et surtout les féministes les plus radicales qui s’en réapproprient inconsciemment la charge subversive et violente, par un phénomène réactif de confusion mimétique.
Il est ainsi très fréquent de voir ces féministes ultra, piégées par les stéréotypes qu’elles combattent et par leurs distorsions symboliques, mettre en scène leur hostilité viscérale à la gent masculine en s’appropriant ces stéréotypes et en les utilisant comme des armes lancées contre leurs oppresseurs déclarés.
Ce n’est plus le théâtre héroïque de « la guerre des sexes » de nos parents, c’est la tragédie pathétique et funeste de « la haine de l’autre ». Une tragédie qui traverse tous les clivages identitaires et communautaires, notamment des identités sexuelles ou de genre. Et qui transforme l’arène politique et médiatique en ring de catch.

Un exemple particulièrement éloquent à ce sujet est la dramaturgie et la symbolique utilisées par les Femen.
Leur « uniforme » joue en effet sur une symbolique excessivement perverse et équivoque. Leurs seins dénudés (une signature) n’évoquent aucunement quoi que ce soit qui pourrait attiser désir. Ni correspondre à l’icône des seins dénudés de la « mère nourricière ».
Au contraire les seins et la poitrine projeté vers le regard comme une main qui agresse sont souvent lacérés de slogans peints en noir qui zèbrent le corps d’une façon agressive, admonitoire voire volontairement blasphématoire.
La nudité surexposée capte le regard et assigne à la provocation. Elle n’est pas « montrée », mais exhibée, projeté, jeté à la figure. Avec une charge de violence subversive calculée selon les lieux publics où elle d’affiche : rue, place, et même parfois certains lieux « sacrés » volontairement profanés : églises, temples, hauts lieux voués au culte de Dieu ou de la République…
Quant au reste de l’uniforme Femen, il est invariablement composé pour le bas du corps d’un pantalon noir, souvent un jean sombre, plus rarement un treillis ou une jupe uniforme noire assortie de bas noirs et de chaussures noires. Le tout accompagné de poses guerrières ou pastichant l’attitude dominatrice et flagellante des maîtresses dans les rituels sadomasos.

La symbolique est évidente, soulignée par la mise en scène très théâtrale (cris et slogans ultra violents, attitude rebelle et agressive…) : transgression, provocation, admonition, violence, castration voire plagiat sataniste (comme le plagiat du film l’Exorciste avec crucifix plantés dans le vagin sur la Place Saint-Pierre de Rome pour protester contre la venue du pape à l’ONU…)
Cette dramaturgie n’est ni fortuite ni gratuite. Elle n’entend pas seulement choquer, provoquer et attirer l’attention forcer le regard mais délivrer un message.
Un message explicite peint sur la poitrine et hurler aux passants. Et un message implicite beaucoup plus subliminal.
Car cette exhibition militante n’a paradoxalement rien de ludique, de situationniste ni de sexuel.
Au contraire, ce qu’évoquent les manifestations Femen, c’est la répression la plus noire du sexe. Ces femmes sont exhibées volontairement comme celles que l’on traînait autrefois ligotées et seins nues sur des charrettes pour les conduire à l’échafaud. Comme ces furies sorties de l’enfer pour emporter les âmes impies.
La façon dont leur corps semble tourmenté, lacéré, profané, presque martyrisé évoque plus la souffrance et la violence que l’image d’une féminité heureuse, aimable et sereine. Encore moins hyper lascive.
Ces corps sont des corps de femmes, et pourtant ils paraissent souvent androgynes. Seuls les seins et la chevelure attestent que ce sont bien des femmes qui s’exhibent. Les hanches, l’abdomen et tout ce qui se rapporte au sexe de la femme dans ses rondeurs et ses cavités intimes est obéré, inexistant, noirci, absent.
Quant à leur attitude, elle est éminemment « phallique ».
Ces êtres hermaphrodites, fanatiques et démoniaques, semblent surjouer l’hybridation, la souffrance de ne pouvoir être soi. Celle d’une identité confisquée, ligaturée, accaparée. Sans doute par leurs propres discours dont elles deviennent les panneaux d’affichage et les porte-voix consentants.
Surjouée à l’excès semble être aussi cette violence brutale et irascible reprochée habituellement aux mâles ou à la société pour en produire un avatar monstrueux, incarné sur le mode de l’hystérie vengeresse.
Mais il y a plus que cette exhibition malsaine. Derrière ce fracas théâtral et provoquant, il y a une idéologie beaucoup plus insidieuse qu’on ne saurait considérer à la légère.
Une idéologie qui accapare autant les hommes que les femmes, pour en faire les marionnettes d’une tragédie éternelle, factice et désespérée. D’un combat démiurgique et primitif dont la haine est le seul moteur et la seule issue.
Cette idéologie qu’on peut nommer féminicisme est un avatar pervers et extrémiste du juste combat féministe.

Un avatar d’autant plus injustifié et nocif qu’il tend à cannibaliser de façon totalitaire tout le mouvement féministe, et à kidnapper les femmes dans un chantage odieux du type « Avec nous ou contre nous ! »
Exactement comme les islamistes qui pour réaliser leur agenda opèrent un véritable kidnapping sur toute la « communauté » musulmane.
Cette idéologie qui n’est plus du tout libertaire ni égalitaire mais identitaire et totalitaire, est extrêmement pernicieuse. Pour les femmes, pour les hommes et pour la société.
Ceci est particulièrement flagrant avec la campagne démagogique et totalement instrumentalisée en 2018 sur le thème #balancetonporc.
L’outrance était évidente, qui prétendait vouloir faire croire que tous les hommes étaient peu ou prou des violeurs et des harceleurs en puissance. Que derrière chaque désir masculin pour une femme se cachait un porc lubrique sans aucune manière ou un loup sanguinaire.
Beaucoup de femmes dont beaucoup de féministes se sont heureusement élevées contre cette campagne. Elles ont été aussitôt insultées, traitées de « salopes », de « putes », de « collabos ». Simplement parce qu’elles avaient osé défendre le droit à la séduction. Et se sont opposées à une culpabilisation universelle des hommes allant jusqu’à la pénalisation du flirt ou de la galanterie.
Ces féminicistes castratrices n’ont que faire du féminisme ou des droits des femmes. Encore moins de la féminité. Ces discours militants ne sont tout au plus qu’une façade, un prétexte, une justification à leur haine. Ce qu’elles veulent c’est uniquement assouvir leur misandrie réactive, pathologique et meurtrière. Tuer tous ces sales mecs. Ou, si ce n’est pas possible, les castrer dès la naissance afin qu’ils ne puissent pas nuire aux femmes et à la société.
Un tel excès de haine relève évidemment de la pathologie psychiatrique. Et d’un sexisme radical qui s’ulcère à la seule idée que le sexe mâle puisse encore exister.
Qu’en est-il de l’avenir ?

Aujourd’hui, entre les outrances machistes de Zemmour et celles hystériques des Femen, c’est à se demander s’il est encore possible en France de défendre sereinement des causes justes, sans sombrer dans l’exhibitionnisme et les manipulations hystériques, ces méthodes duplices et ces propos disproportionnés, qui au final desservent autant les femmes que les hommes.
Tout nous permet de douter que la complaisance politiquement correcte et clientéliste des politiques qui continuent d’aboyer avec « celles et ceux » qui crient le plus fort pour se donner bonne conscience, en perdant le sens des priorités et de la façon la plus efficace d’engager la responsabilité des politiques publiques, soit de nature à faire avancer les choses en faveur des femmes.
Encore moins à faire reculer les violences.
Qu’on songe à cette ridicule et démagogique « Grande cause national » consacrée aux « féminicides » l’an dernier.
Un sujet certes très important et qui mérite qu’on engage rapidement des moyens appropriés pour protéger, éduquer et prévenir. Mais surtout une mise en scène gratuite et même obscène qui joue plus sur les affects, le spectaculaire, la manipulation, la surenchère, et une culpabilisation victimaire permanente des hommes et de l’opinion, que sur une volonté sincère de résoudre efficacement le problème.

D’ailleurs moins de 150 cas recensés par an, c’est certes 150 de trop, mais force est de reconnaitre honnêtement qu’il y a en France bien des tragédies, et des « causes » ô combien essentielles, qui mériteraient d’être promues au rang de « Grande cause nationale ».
Car le but de ce néologisme féminicide, de cette politique ultra agressive, de ce décompte quotidien obscène des morts, et des discours dogmatiques qui les accompagnent, c’est avant tout d’essentialiser les femmes dans un statut de « victimes par nature ».
Une femme, parce qu’elle est une femme, et parce que les hommes – ou « la société machiste, sexiste et patriarcale… » – sont ce qu’ils sont, sont toutes par essence des victimes.
Et les hommes, parce qu’ils ont un pénis et vénèrent leur phallus, sont tous par essence des bourreaux.
Ce sont irrémédiablement par essence des êtres lubriques, stupides, agressifs, violents, des flambeurs, des dragueurs, des emmerdeurs, des harceleurs, des violeurs et des assassins en puissance.
Une façon d’essentialiser des caractéristiques animales fort discutables sur le comportement des mammifères. Et de transformer cette éthologie de l’homo sexualis en une anthropologie universelle du masculin qui résume l’homme à ses pulsions sexuelles, reproductives et agressives.
Une façon d’évacuer toute forme de civilité ou de culture dans la gestion des comportements humains entre les hommes et mes femmes, et d’abolir ainsi des centaines de milliers d’année d’évolution de l’espèce humaine.
Une façon implicite de sous-entendre que seules les femmes auraient pu jouer dans l’Histoire humaine et dans nos sociétés contemporaines un rôle « civilisateur », en réprimant les pulsions agressives de l’espèce dont les mâles sont esclaves au bénéfice des qualités régulatrices et civilisatrices réputées abusivement « féminines ».
Un vieux thème ressassé par le mouvement féministe depuis les années 1960, fondée sur de vieilles rengaines obsessives accréditées par certains historiens, sociologues ou anthropologues féministes plus ou moins sincères et leurs théories sur la prise du pouvoir par les hommes dans les sociétés matriarcales transformées en sociétés patriarcales.
Avec tous les mythes et clichés habituels selon lesquels les sociétés matriarcales seraient plus pacifiques, moins violentes, plus proches et plus respectueuses de la nature, des autres espèces, plus égalitaires, moins individualistes et davantage tournées vers le collectif. Des sociétés qui valoriseraient une sexualité libre et non réprimée, seraient fondées sur une économie du partage et de la redistribution, seraient moins axées sur la rivalité, la compétition, la conquête, le pouvoir, et qui auraient développé des formes d’organisation et de transmission plus équitables, moins centrées sur la propriété, moins idéalistes. Des sociétés plus humaines en somme.
Avec en arrière-plan le mythe du « bon sauvage » et la fascination contemporaine pour les sociétés primitives qualifiées abusivement de « non-violentes », proche de la nature, à une époque ou l’écologie nourrit fantasmes, angoisses et culpabilités.
A l’inverse les sociétés dites patriarcales seraient dominées par des mâles grossiers et brutaux, jaloux et dominateurs, souvent polygames, considérant les femmes comme du simple bétail. Elles seraient davantage tournées vers la chasse, la conquête de nouveaux territoires, la guerre, la compétition, la technique, des systèmes politiques et organisationnels hiérarchiques, la sacralisation du pouvoir et de l’autorité, une justice plus arbitraire et impitoyable. Ces sociétés auraient tendance à réprimer, codifier et normaliser la sexualité selon des modèles et des coutumes strictes, à proscrire l’homosexualité et les « déviances ».
Elles se caractériseraient par des formes religieuses fondées sur la vénération de dieux masculins, tout-puissants, colériques et autoritaires, souvent associés aux forces célestes, cosmiques et telluriques comme le soleil, le tonnerre, la foudre, les volcans. Elles seraient tout entière organisé selon une symbolique « phallique », militaire, idéalisant la force brute, réprimant ce qui relève de l’intime, de l’émotionnel, du sensible et du sensuel, assimilés à des faiblesses féminines. Les hommes auraient tendance à préconiser une indifférence envers les plus faibles, les malades et les peuples jugés inférieurs. Etc, etc…

Isis et Osiris
Bien entendu tout ceci n’est pas entièrement faux. Mais comporte une large part de subjectivité et d’arbitraire. La réalité est beaucoup plus complexe et continue que ces schémas à l’emporte-pièces. Surtout lorsqu’ils sont nourris de préjugés qui orientent le regard de ceux qui élaborent ces théories.
Les discours qui ordonnent et orientent ces modèles anthropologiques construits à partir du 20e siècle à propos des sociétés anciennes comportent à l’évidence une part d’idéalisme mais aussi de projections morales dictées par la mauvaise conscience de « l’homme blanc occidental hétérosexuel ».
Le pire c’est que beaucoup aujourd’hui croient encore honnêtement à tous ces stéréotypes comme des vérités sacrées et irrévocables. Des vérités qui sonnent d’autant plus justes sous la petite musique du « Progrès » que notre société semble de plus en plus obsédée par une surenchère moralisante et politiquement correcte sur le questionnement ses « stéréotypes de genre ».
Toutes ces spéculations et théorisations fondées sur cette thématique binaire et dialectique entre cultures patriarcales et matriciales est une formidable bévue et une impasse conceptuelle. Elles ne servent qu’à légitimer et renouveler des schémas anciens et dépassés où le monde serait segmenté et le mouvement de l’Histoire orienté selon des logiques d’organisation et de pouvoir calibrées à partir de critères de différenciation sexiste élargie au référents anthropologiques, structurels, institutionnels, politiques, économiques et culturels.
Cette ordonnancement de l’Histoire humaine est encore moins pertinente quand elle s’amalgame avec d’autres angoisses et préoccupations générales et des prospectives futurologiques sur la mondialisation ou l’écologie. Notamment par exemple avec ces théories américaines fondées sur le concept d’écoféminisme qui associe la conscience écologique planétaire à la redistribution des modèles et critères différenciatifs du féminin et du masculin, à l’articulation des valeurs et des rôles politiques respectifs incarnés par les hommes et les femmes dans les sociétés.
Derrière une apparence de renouvellement de la pensée, cette philosophie écoféministe n’est rien de moins qu’une projection de type idéaliste et sentimentalo-romantique sur fond d’angoisse écologique et d’une tentative supplémentaire d’essentialiser le combat féministe en le reliant aux questions environnementales. Et, d’un point de vue symbolique et spirituel, une volonté de revisiter des mythes archaïques ou plus contemporains et des archétypes symboliques associés à la « nature » (Terre Mère, Gaïa…) ou projetés sur une « Nature » idéalisée dont la genèse remonte pour sa partie occidentale aux conceptions philosophique et théologiques médiévales sur l’Ordre de la Nature, reflet d’un prétendu Ordre Divin.
 En définitive l’écoféminisme n’a d’autre racine véritable que la culpabilité occidentale de l’homme blanc face aux ravages causés à son environnement par une frénésie de conquête, de soumission et d’exploitation, et la perturbation catastrophique des équilibres qui menacent la survie de l’espèce. Une façon de conjurer l’angoisse, de refréner les appétits « masculins » de conquête, et d’anticiper un retour de flamme de « la Nature » qui sonne comme une punition infligée par une une divinité courroucée à une humanité intempérante. Une façon de se réfugier gans le giron d’une « Nature » fantasmée comme bonne et nourricière en abdiquant toute prétention trop « masculine » à la dominer, et en renversant l’ordre symboliques des valeurs pour se conformer aux stéréotypes d’une sagesse « harmonieuse et pacifique » projetés sur le féminin.
En définitive l’écoféminisme n’a d’autre racine véritable que la culpabilité occidentale de l’homme blanc face aux ravages causés à son environnement par une frénésie de conquête, de soumission et d’exploitation, et la perturbation catastrophique des équilibres qui menacent la survie de l’espèce. Une façon de conjurer l’angoisse, de refréner les appétits « masculins » de conquête, et d’anticiper un retour de flamme de « la Nature » qui sonne comme une punition infligée par une une divinité courroucée à une humanité intempérante. Une façon de se réfugier gans le giron d’une « Nature » fantasmée comme bonne et nourricière en abdiquant toute prétention trop « masculine » à la dominer, et en renversant l’ordre symboliques des valeurs pour se conformer aux stéréotypes d’une sagesse « harmonieuse et pacifique » projetés sur le féminin.
Une partie de notre société adopte sans le dire ni le savoir ces stands écoféministes. A tel point que la conformité à tout stéréotype du masculin dans les formes, les codes sociaux ou les discours devient parfois immédiatement suspecte.
Un véritable tyrannie s’instaure, notamment depuis une ou deux décennies aux Etats-Unis, où plus aucun conflit, plus aucune friction ni vexation, et plus aucune suspicion de questionnement de critères personnels identitaires ou communautaire n’est toléré. Tout écart de langage ou de comportemental aussi minime soit-il, toute parole qui met en cause implicitement la qualité d’un individu, est aussitôt qualifié d’agressif ou de violent. Un seul terme résume cette hystérisation des relations : celui de micro-agression. Un concept qui est un peu l’enfant naturel de la violence des sociétés postmodernes ajoutée à la tyrannie du politiquement correct hypernormatif. Toute expression ou geste public, aussi banal soit-il, qui peut-être interprété comme une insinuation, une intimidation, une dénégation de critères identitaires, peut valoir à son auteur l’accusation de micro-agression.
Cette tendance à la répression constante des opinions, des affects, du langage produit une infinité de phénomènes réactifs et de décompensations sur le registre de la provocation, de l’exhibition, de la rebellion et de l’outrance. Lesquels renforcent cette angoisse et cette suspicion en retour.
S’agissant de modes d’affirmation identitaire propre à la masculinité, le simple fait pour un homme de cultiver son apparence, de mettre en scène des postures, des comportements ou des discours pour se valoriser en affichant une virilité décomplexée est immédiatement catalogué comme une forme de « machisme ».
De même, dans certains milieux rigoristes, une femme qui fait étalage de sa beauté et de ses charmes ou construit son personnage en un intégrant des codes de la séduction peut aussitôt être taxée de « femme légère », de « salope » ou de « putain ». Alors que les médias et les couvertures de magazines surjouent en permanence les codes de la masculinité comme de la féminité, incitant hommes et femmes à se définir à partir de ces standards dictés par le marketing.
L’exemple le plus éloquent de répression de la féminité est évidemment symbolisé par le voile islamiste, qui oblige toutes les femmes à disparaître derrière un accoutrement qui dissimile les formes, la chevelure, une partie du visage et parfois le corps tout entier. La seule manière aux dires de certaines musulmanes des quartiers sensibles d’échapper à la prédation masculine. Mais aussi en dehors de toute question religieuse une façon d’assigner les femmes à un modèle comportemental sinon à un uniforme derrière lequel toute identité personnelle et sexuée disparaît.
Ainsi notre siècle offre un vertigineux paradoxe puisqu’il prétend émanciper les femmes, briser les assignations identitaires et sexistes, mais dans le même temps il jette occasionnellement la suspicion sur l’affichage de critères distinctifs évoquant des caractères forts du féminin ou du masculin.
C’est justement de cette confusion et de ces injonctions paradoxales dont il faudrait sortir.
Les femmes sont-elles plus libres aujourd’hui qu’hier ? Oui, évidement ! Mes hommes sont plus conscients et respectueux du statut des femmes dans notre sociétés postmoderne ? Encore oui dans leur écrasante majorité.
Reste la question de la régulation des violences dont les femmes font l’objet. Et celles dont certains sont aussi victimes de la part des femmes.
L’évolution historique de ces réalités est complexe et a connu des avancées comme des régressions. Le mythe du Progrès nous aveugle quand nous le plaquons sur une vision rétrospective des siècles passés et projetons nos angoisses sur un passé mythifié de façon positive ou négative.
En tout cas la place qu’occupaient réellement les femmes dans les sociétés antiques, médiévales durant la Renaissance, le Grand Siècle ou celui des Lumières n’a souvent rien à voir avec cette désopilante caricature d’une lente montée des ténèbres machistes vers la lumière féministe.
Rien que si l’on considère la France du Grand siècle à partir du règne de Louis XIV, les femmes y occupaient une place de premier rang et jouissaient d’un pouvoir considérable. La préciosité chère à Molière avait codifié jusqu’au paroxysme les usages de la société aristocratique et des salons mondains des belles marquises. Une invention aussi intelligente et raffinée que redoutable, qui permettait aux femmes les plus brillantes de tenir à distance leurs prétendants, de multiplier les codes et les rites de la séduction selon la Carte du tendre, et se mettre en scène dans un théâtre très privé et très prisé voué au bel esprit, à la galanterie, aux fastes et aux élégances de la Cour.

Combien de favorites, de duchesses et de reines d’un soir rayonnaient ainsi en faisant tournoyer autour d’elles, dans leurs appartements pleins d’apparat, tout un aréopage de satellites masculins en pourpoint, perruque et jabot, au verbe flûté, au visage poudré, maquillés, emplumés, aux mimiques plus maniérées que des folles de music-hall ? Tout cela pour arracher un soupir à ces précieuses pas si ridicules que cela et ces femmes savantes.
Ce sont bien les femmes qui tenaient le pouvoir sur bien des points. Le roi s’en amusait. Elles en usaient parfois avec une jouissance et une cruauté sadique, aussi décomplexée qu’offerte au regard de tous.
On pourrait citer ainsi bien d’autres époques et d’autres lieux que Versailles où les femmes ont dicté leur loi à des hommes réduits à faire les singes pour espérer un jour parvenir à leurs fins.
Evidemment en comparaison notre époque est beaucoup plus trash.

La Fouine
La vulgarité, l’obscénité, l’arrogance, l’insolence, l’impertinence, la désinvolture, l’outrance, la provocation, la transgression, l’exhibitionnisme, le cynisme, la méchanceté gratuite, la fatuité, la vanité sont autant de « vertus » dont il faut savoir user si l’on veut se faire entendre, considérer et respecter. Pas de places les mous, les fades et les faibles !
Plutôt que de cataloguer tous les hommes (et parallèlement toutes les femmes) selon les canons du politiquement corrects et de s’entêter dans une surenchère culpabilisatrice, castratrice et moralisatrice, peut-être serait-il plus constructif de considérer que la recrudescence des violences infligées est un symptôme de dysfonctionnements structurels de nos sociétés.
Au lieu de justifier ces angoisses, ces ressentiments réactifs et la haine mimétique de certaines femmes envers les hommes alimentée par ces violences par des discours idéologiques et victimaires qui essentialisent la gent féminine comme une éternelle victime.
L’enjeu n’est pas comme le voudraient certaines salafistes d’émasculer physiquement ou symboliquement tous les mâles afin de conjurer dans l’espoir de conjurer définitivement ces dérives « machistes » et ces violences. Ni de réclamer vengeance en désignant des coupables dans tous les milieux où le pouvoir couvre d’objectives injustices voire des crimes comme le viol ou le harcèlement sexuel. Encore moins de jeter a priori le discrédit sur l’autorité du mari et du « père de famille » au seul motif qu’une infime proportion des hommes mariés se comportent comme d’authentiques goujats ou commettent des violences envers leur épouse.
Sans reconnaissance sereine et de honnête de l’existence d’une violence féminine spécifique incarnée par ces militantes ultra du « féminicisme », mais aussi par les violences conjugales commises par des femmes à l’égard de leur conjoint, symétriques sinon égales à celles des hommes violents, il est impossible d’opérer un rééquilibrage et de pacifier l’éternelle « guerre des sexes » qui envenime les relations interpersonnelles et sociales et contaminent les discours politiques, selon les logiques du rapport de forces, de la concurrence victimaire, de l’arbitrage des pouvoirs selon les schémas de domination-rébellion, autant de mécanismes qui alimentent le cycle infini de la violence.
C’est aux femmes autant qu’aux hommes de démontrer que nous vivons dans une époque civilisée et toujours civilisable. De prouver que chacun est capable de rencontrer l’autre, de respecter les écarts et les différences pour ce qu’elles ont de positivement structurant, sans inhiber la dynamique du désir, de rencontre et de la relation, et sans ignorer la nécessité de la limite comme fondement de la sémantique identitaire, amoureuse, conjugale, sociale, juridique et politique.
Mais aussi de ne pas céder aux injonctions de l’esprit du temps. A cette dictature morale de type totalitaire du politiquement correct. Une morale faite d’injonctions discursives et comportementales qui dénaturent la dynamique relationnelle, faussent l’expression et la considération envers toute forme d’altérité, figent les modèles de l’agir personnel et collectif selon une hypervalorisation de l’image, du paraître et de la norme. Et stimulent en retour toutes les déviations, toutes les décompensations, toutes les transgressions et tous les désordres.
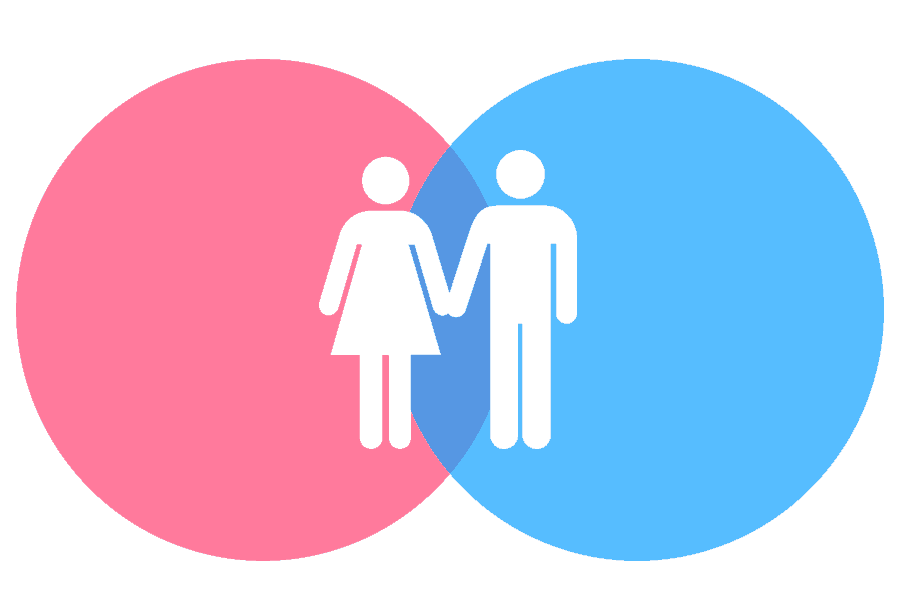
Il serait temps qu’hommes et femmes s’accordent non pas sur des comportements admis ou proscrits, tous également fondés sur la suspicion ou le rejet, mais sur une éthique commune de la dignité, du respect bienveillant de l’autre et de la coresponsabilité. Au lieu de rejeter indéfiniment la faute sur l’autre dans des processus de victimisation, de culpabilisation, de condamnation qui engendrent toujours plus de suspicion, plus de haine et plus de violence.
Il serait temps qu’hommes et femmes en conflit les uns envers les autres s’accordent sur la nécessité de conjurer leurs peurs réciproques par effort commun de reconnaissance, de pacification, d’apprivoisement et de rééducation mutuels, plutôt que de nourrir trop facilement des schémas réactifs de type misogyne ou misandre. Ou de nourrir les rapports de force, la guerre des sexes et la justification du désir de domination de l’autre.
Et pour cela, il faut impérativement sortir des schémas binaires, identitaires et sexistes. Des logiques qui conduisent à pérenniser artificiellement des stéréotypes sociaux et comportementaux fondés sur le genre associé au sexe, des stéréotypes aujourd’hui totalement démentis par les discours et les modèles dominants, mais aussi et surtout par l’évolution objective, historique, culturelle, sociale et anthropologique des sociétés postmodernes occidentales.
Les changements rapides imprimés par les évolutions sociétales liées à l’identité, aux différents types d’unions, de familles, à la sexualité, à la procréation, à la filiation, à la parentalité, à la responsabilité partagée ou fragmentée au sein de la société ont totalement bouleversé les arcanes traditionnels qui fixaient la norme des pouvoirs et de l’ordre établis. En assignant hommes et femmes à des identités, des rôles et des comportements précis.
La rapidité et la profondeur de ces changements affectent non seulement nos représentations culturelles sur le masculin et le féminin, Elles réveillent aussi des peurs archaïques sur l’être personnel et l’être social de chacune et de chacun. Les angoisses souvent inconscientes que ces bouleversements génèrent se traduise souvent par un retour du refoulé, par des crispations et des réactions agressives, une volonté de se réapproprier de façon outrancière ou falsifiée une identité, une légitimité, un statut sources de pouvoir et d’autorité qui paraissent perdus.
Les hommes sont autant sinon plus en crise aujourd’hui que les femmes avant d’accéder à leur émancipation. Les modèles traditionnels du masculin sont désavoués et donc la plupart du temps surjoués par bon nombres d’adolescents pour satisfaire un désir d’affirmation égotique et sociale.
Face aux revendications du féminisme émerge une forme symétrique toute aussi idéologique, sociale et politique de masculinisme, notamment aux Etats-Unis. Un mouvement qui vise à compenser les effets dévastateurs sur les hommes des excès du féminisme. Un effort de reconstruction et de réappropriation identitaire collectif au travers notamment de « groupes d’hommes » destinés à stimuler la confiance en soi, le sentiment d’appartenance à une même fratrie et guérir les blessures narcissiques infligées aux hommes par l’agressivité et la culpabilisation féministes de leurs mères, de leurs sœurs ou de leurs conjointes.

Ce mouvement tend à promouvoir une forme d’homophilie réparatrice destinée à compenser le manque de proximité amicale, sensuelle et affective éprouvée au contact intime mais non sexuel avec d’autres hommes. Une façon d’intégrer, d’accepter et de vivre une sensibilité et une émotivité que beaucoup d’hommes se refusent ou se voient refuser, sinon en devenant le jouet de femmes perverses qui cherchent à les déviriliser ou les manipuler.
Parallèlement, les hommes en quête d’eux-mêmes réapprennent les vertus du défi, de l’audace, du courage, la maîtrise de la force physique, de la compétition, de la combativité, de l’endurance, de la réussite, de la fierté, sinon d’une certaine forme positive d’agressivité, autant de vertus masculines qu’ils s’étaient habitués à refouler ou réprimer et réapprennent à vivre de façon honorable et positive. Une façon de s’émanciper des injonctions contemporaines dévirilisantes liées aux « persécutions » féministes, aux discours culpabilisants identifiant la violence à la masculinité, au brouillage des genres, et à une certaine forme consciente ou insidieuse de féminisation des hommes.
Au final, les violences que l’on désigne uniquement comme des crimes appelant sentence collective et justice impartiale sont bien plus des stigmates d’une société en souffrance et d’individus qui peinent à remodeler leurs repères.
Plutôt qu’une volonté impitoyable de traquer en chaque homme ou en chaque femme les signes d’une violence plaquée par les projections victimaires, il serait bien plus juste et efficace de cultiver l’indulgence, la bienveillance, la patience, la modération. Autant de vertus personnelles mais aussi culturelles et sociales qui relève d’une forme d’amour et de pardon.

Hommes et femmes sont blessés. Inutile de tirer sur un cortège d’ambulances. A nous de réparer, de faire preuve de vigilance mais aussi de magnanimité. De renoncer à condamner en bloc l’autre sexe à cause de comportements isolés et de crimes qui doivent être prévus et sanctionnés.
Ne nous identifions pas à ce désir, juste a priori, de justice. Un désir qui au lieu d’apporter la paix peut nourrir la guerre, le désordre et les violences de tous ordres. Car si ce désir traduit un amour bon et légitime pour soi-même, il ne peut y avoir de justice qui ait de vraie valeur sans l’exercice parallèle d’une certaine miséricorde.
Sans elle, individus et sociétés se condamnent à répéter sempiternellement le cycle meurtrier de la violence, pour finir un jour par s’autodétruire.


















 En définitive l’écoféminisme n’a d’autre racine véritable que la culpabilité occidentale de l’homme blanc face aux ravages causés à son environnement par une frénésie de conquête, de soumission et d’exploitation, et la perturbation catastrophique des équilibres qui menacent la survie de l’espèce. Une façon de conjurer l’angoisse, de refréner les appétits « masculins » de conquête, et d’anticiper un retour de flamme de « la Nature » qui sonne comme une punition infligée par une une divinité courroucée à une humanité intempérante. Une façon de se réfugier gans le giron d’une « Nature » fantasmée comme bonne et nourricière en abdiquant toute prétention trop « masculine » à la dominer, et en renversant l’ordre symboliques des valeurs pour se conformer aux stéréotypes d’une sagesse « harmonieuse et pacifique » projetés sur le féminin.
En définitive l’écoféminisme n’a d’autre racine véritable que la culpabilité occidentale de l’homme blanc face aux ravages causés à son environnement par une frénésie de conquête, de soumission et d’exploitation, et la perturbation catastrophique des équilibres qui menacent la survie de l’espèce. Une façon de conjurer l’angoisse, de refréner les appétits « masculins » de conquête, et d’anticiper un retour de flamme de « la Nature » qui sonne comme une punition infligée par une une divinité courroucée à une humanité intempérante. Une façon de se réfugier gans le giron d’une « Nature » fantasmée comme bonne et nourricière en abdiquant toute prétention trop « masculine » à la dominer, et en renversant l’ordre symboliques des valeurs pour se conformer aux stéréotypes d’une sagesse « harmonieuse et pacifique » projetés sur le féminin.